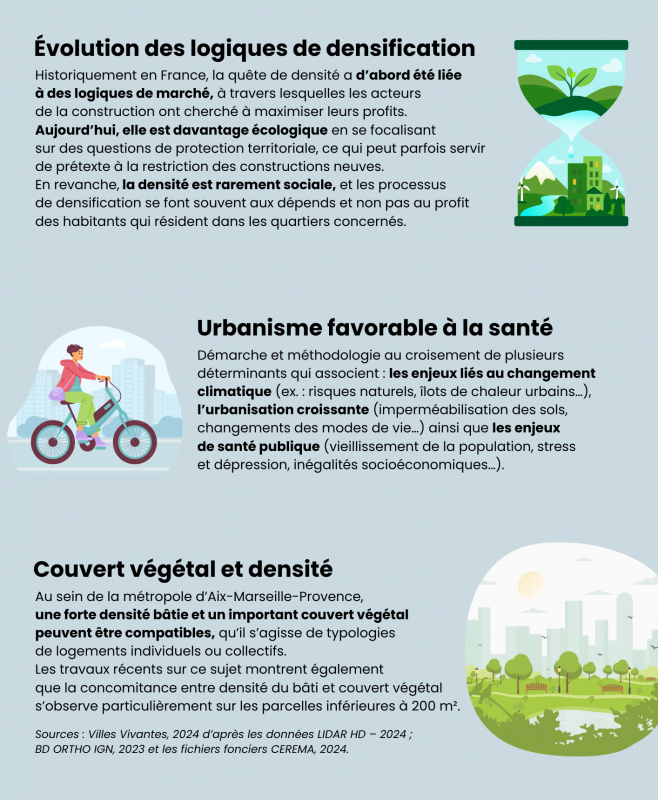Intitulée « L’intensification urbaine : mal-aimée ou désirée ? », la dernière conférence a réuni trois intervenants issus des sphères académique et institutionnelle et a permis de mettre au centre des discussions l’incontournable question de la désirabilité, par les habitants et les usagers, des villes denses et intenses.
L’intensification urbaine au prisme de la désirabilité des habitants
Catherine Sabbah, déléguée générale du réseau de l’Institut des hautes études pour l’action dans le logement (IDHEAL), a d’abord mené une introduction sur la question des logements dans les grands ensembles et de la densité qui leur est souvent associée de manière péjorative. Puis elle explique qu’il existe en réalité plusieurs manières d’aborder les sujets de densité et d’intensification urbaine. Selon elle, ces thématiques sont fortement corrélées à des ressentis et à des perceptions individuelles. Si les grands ensembles ont généralement mauvaise presse et s’inscrivent comme des cas de densité urbaine rejetée, ils sont souvent bien moins denses (en termes d’habitants ou de m² à l’hectare) que certains quartiers urbains qui ont pourtant une bien meilleure réputation. Pour illustrer son propos, Catherine Sabbah convoque notamment l’exemple du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, particulièrement dense certes, mais aussi particulièrement apprécié des habitants et des touristes.
L’intensification urbaine : mal-aimée ou désirée ?
Elle présente ensuite les principales caractéristiques prises en compte dans le cadre de l’étude #DÉSIR – Densité Éprouvée Souhaitée Imaginée Redoutée (2023)1. Cette démarche considère à la fois : des données chiffrées (m² bâtis à l’hectare ou nombre d’habitants à l’hectare), des formes urbaines (grands ensembles collectifs ou pavillonnaire serré), des ambiances urbaines (cadre sonore, densité de population, intensité ressentie), des enjeux politiques (conséquences de la construction sur les élections et confrontation de l’hypothèse selon laquelle « un maire bâtisseur est un maire battu ») ainsi que des données analysant les ressentis des usagers sur la densité acceptable, désirable ou accessible. D’après l’intervenante, il est essentiel d’opérer une distinction entre ces différentes notions. Il est en outre fondamental de poser en priorité la question de la densité acceptable qui permet de dépasser les enjeux de rentabilité économique souvent recherchés par les constructeurs et les opérateurs immobiliers. Or une telle approche fait généralement l’impasse sur la qualité intrinsèque des logements. Catherine Sabbah et ses collègues ont démontré que « la densité et la standardisation avaient beaucoup œuvré pour la mauvaise qualité du logement au cours des 20 ou 30 dernières années ». Ces éléments ont pu participer du rejet généralisé de la densité qui se répercute, en France, sur les projets de constructions neuves contre lesquels les habitants ont tendance à s’opposer systématiquement par le biais de recours. Elle parle ainsi « d’une opposition au fait d’avoir des voisins qui pose un certain nombre de questions sur le vivre-ensemble et la permanence du contrat social ».
Finalement, pour Catherine Sabbah, la densité doit nécessairement être accessible pour être acceptable, et certains acteurs (aménageurs, urbanistes…) peuvent agir en ce sens. En outre, le fait d’informer les habitants (notamment en les intégrant davantage à la coconstruction des principaux documents d’urbanisme) et de favoriser un aménagement du territoire profitable aux populations déjà présentes sur les périmètres concernés pourrait favoriser une plus grande acceptabilité de la densité urbaine.
Des méthodes urbaines pour rendre la ville intense désirable
Puis, Jeffrey Blain (docteur en géographie et enseignant-chercheur à l’ESPI Lyon) explique – à travers un prisme scientifique – les méthodes urbaines qui peuvent contribuer à rendre la ville intense plus désirable. En tant que spécialiste de l’urbanisme favorable à la santé, il s’inscrit dans la continuité de la première intervention où les questions de qualité de vie et d’urbanisme du care ont été soulevées. Selon le chercheur, si la désirabilité de l’intensification urbaine n’est pas un sujet directement corrélé aux problématiques de santé en ville, elle permet néanmoins de valoriser les démarches, les méthodes et les enjeux liés à un cadre de vie urbain plus sain et plus agréable. D’une manière générale, « l’urbanisme est un déterminant de l’environnement mais aussi un moyen d’agir pour la santé ». Autrement dit, il existe des « cobénéfices entre santé et environnement », ce qui signifie que ce qui est bon pour la santé est bon pour l’environnement et vice versa.
En outre, il précise que plusieurs métiers sont concernés par la démarche d’un urbanisme favorable à la santé. Cette dernière concerne ainsi prioritairement les aménageurs, les urbanistes, les promoteurs immobiliers et, bien sûr, les professionnels du secteur de la santé. En réunissant une telle diversité d’acteurs, l’objectif est « d’identifier et de répondre au mieux aux enjeux locaux et spécifiques de chaque territoire ». Pour le mener à bien, les acteurs impliqués dans l’urbanisme favorable à la santé doivent également opérer des choix d’aménagement territorial. Parmi les principaux choix œuvrant à la fois en faveur de l’urbanisme opérationnel favorable à la santé (UoFS) et de l’intensification urbaine, on compte : la qualité des logements, l’accessibilité à l’emploi, aux équipements et aux services, la fonction sociale des espaces, la proximité des espaces publics ou encore la présence d’espaces végétalisés. Ces éléments contribueraient donc à rendre les territoires plus sains et plus désirables tout en maximisant leur intensité.
Dans la continuité de ces éléments théoriques, Jeffrey Blain présente plusieurs exemples concrets. Le premier est un projet immobilier situé à Lyon, dans l’écoquartier réhabilité de La Confluence par le promoteur Linkcity (filiale du groupe Bouygues). Plus précisément, il s’agit du programme « Eurêka Confluence » (figure 4), qui accueille en son sein un îlot « Santé et bien-être » de 1 170 m² composé d’un centre de santé au travail ainsi que de plusieurs autres services dédiés à la prévention et à la santé (présence de médecins généralistes et spécialistes notamment). Cet îlot s’inscrit dans un programme favorisant une mixité fonctionnelle (logements, logements sociaux, bureaux, commerces) au cœur des définitions de la ville intense.
L’intensification urbaine en contexte
Figure 4 . Favoriser la santé dans les nouveaux programmes immobiliers : le programme « Eurêka Confluence » à Lyon – îlot « Santé et bien-être »
Source : Jeffrey Blain, 2024, îlot Eurêka, La Confluence, Lyon.
Le deuxième exemple proposé est celui, bien connu, de la ville du quart d’heure, popularisée par Carlos Moreno. Jeffrey Blain rappelle que ce concept repose sur la concomitance, dans un périmètre restreint, de six fonctions : habiter, travailler, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer et s’épanouir. Selon lui, la ville du quart d’heure a donc pour ambition « d’intensifier l’offre de services et l’usage de la ville pour réduire les mouvements pendulaires en créant des quartiers multifonctionnels ». Un tel modèle urbain peut en outre répondre à l’UoFS en limitant les émissions de polluants et de particules fines ainsi que les nuisances sonores liées aux déplacements motorisés intra-urbains. Enfin, il prend l’exemple international des super-îlots barcelonais, qu’il a particulièrement étudié. Il constate depuis plusieurs années une réinterprétation voire une « régénération » du plan hippodamien, initié par l’architecte et urbaniste catalan Idelfons Cerda, en construisant des superblocks2. Ces derniers permettent de regrouper plusieurs îlots et de limiter la circulation en leur sein afin d’aménager de nouveaux espaces verts et espaces publics. À travers ce type d’initiative, l’idée est de réduire les effets externes négatifs d’une ville européenne très dense (16 000 hab./km²), très motorisée et très bruyante, afin de rendre cette densité plus désirable.
Pour conclure, Jeffrey Blain souligne que les liens entre intensification urbaine et désirabilité relèvent d’enjeux de santé et qu’il existe une réciprocité entre ces éléments, car l’urbanisme favorable à la santé prône une certaine intensification urbaine.
Densité urbaine, biodiversité et cadre de vie
En dernier lieu, Thomas Hanss, paysagiste et cofondateur de Villes Vivantes, intervient dans la continuité de celle de David Miet lors de la deuxième conférence du cycle.
En propos liminaires, Thomas Hanss revient sur son parcours professionnel, fortement en lien avec l’horticulture et l’aménagement paysager. D’une manière générale, il s’intéresse à la façon dont les espaces verts prennent place et sont conçus au sein des espaces publics. Les éléments présentés sont issus de la coopération entre Villes Vivantes, l’OFCE Sciences Po et la Métropole Aix-Marseille-Provence. Ainsi, il se demande comment mettre l’intensification urbaine au service des transitions du territoire métropolitain. Il s’agit de modéliser, scénariser et mesurer l’impact de l’évolution des densités bâties à l’échelle de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en se focalisant précisément sur la place du végétal dans la ville.
Thomas Hanss réalise d’abord un bref cadrage définitionnel autour de la notion de jardin et la manière dont on peut l’appréhender en ville aujourd’hui. Cela fait une parfaite transition avec la thématique de la santé : il a été démontré scientifiquement que la pratique régulière du jardinage produisait des effets similaires à celle d’une activité physique telle que la marche ou le cyclisme. En outre, les jardins ont un effet particulièrement positif sur la qualité de vie. Plus généralement, l’intensité du couvert végétal peut constituer un élément fort quant à la désirabilité de l’intensification urbaine. Enfin, selon Thomas Hanss, « le jardin, l’accès à la nature ou aux espaces verts, sont des éléments pour lesquels on observe une très forte attente sociale ». De fait, le jardin est particulièrement recherché dans la demande résidentielle, ce qui le rend fortement valorisable, de même que la présence d’un extérieur. Il explique ainsi que, d’après une étude conduite en France en 20223, si la plupart des personnes interrogées (en ville ou à la campagne) souhaitent bénéficier d’un jardin, plus de 70 % d’entre elles privilégieraient de petites et moyennes surfaces. En effet, plus d’un tiers des enquêtés considèrent que le jardin idéal a une superficie inférieure à 250 m². Sur ce point, Thomas Hanss précise que la grande taille des jardins privés n’est pas forcément un avantage pour la biodiversité car cette dernière « est relative à la part de sa surface qui n’est pas occupée par de la pelouse », et souvent, les grands espaces sont composés de pelouse pour faciliter leur entretien.
Après avoir rappelé que, pour optimiser les services écosystémiques liés aux jardins, la clé ne réside pas dans la grande taille des parcelles végétalisées mais plutôt dans le travail des jardiniers, Thomas Hanss présente les premiers enseignements tirés de la modélisation du couvert végétal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence (figures 5a et 5b).
L’intensification urbaine en contexte
Figure 5a. Modélisation du couvert végétal métropolitain : Aubagne
Sources : Villes Vivantes, OFCE, direction Prospective, partenariats et innovations territoriales de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 2025.
Figure 5b. Modélisation du couvert végétal métropolitain : Marseille
Sources : Villes Vivantes, OFCE, direction Prospective, partenariats et innovations territoriales de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 2025.
D’un point de vue méthodologique, cette modélisation repose sur un état de l’art synthétique qui permet de référencer diverses sources de données (LiDAR HD et BD TOPO IGN principalement) et plusieurs études pour analyser la couverture végétale des territoires urbanisés. « Le couvert végétal a été modélisé sur l’espace cadastré (hors domaine public) des zones urbaines résidentielles multifonctionnelles », soit 26 517 hectares de couvert végétal. Sur le périmètre métropolitain, la strate herbacée est ainsi la plus importante, puisqu’elle représente 46 % du périmètre modélisé. Viennent ensuite la strate arborée (19 %) et la strate arbustive (16 %). En outre, cette étude traduit les conséquences de choix historiques en matière d’aménagement. On constate alors une importante corrélation entre un fort taux de couverture arborée et arbustive et une faible densité en logements par hectare. Autrement dit, moins un espace est dense en termes de logements, plus il est susceptible d’être fortement végétalisé. Néanmoins, de nombreuses exceptions existent.
Enfin, Thomas Hanss sélectionne plusieurs exemples au sein du périmètre métropolitain pour comprendre comment se traduisent à la fois l’intensification urbaine et l’intensité du couvert végétal dans diverses unités foncières. Il compare, sur des terrains aux surfaces similaires, le COS, le COS surface habitat (COSh), le couvert arbustif et arboré (CAA) et la couverture herbacée (CH). Les cas présentés révèlent une grande diversité de situations à l’échelle métropolitaine, et ce, indépendamment des surfaces considérées. Ainsi, sur deux terrains d’approximativement 220 m² chacun et comportant un logement de 60 m² dans un cas et de 76 m² dans l’autre, les CAA varient de 5 % (cas 1) à 73 % (cas 2). Pour résumer, Thomas Hanss affirme que : « Toute chose égale par ailleurs, il existe des cas d’école dont on peut apprendre plein de choses, y compris sur des parcelles en densification. »
Conférence 4 du cycle sur l’intensification urbaine : infographie